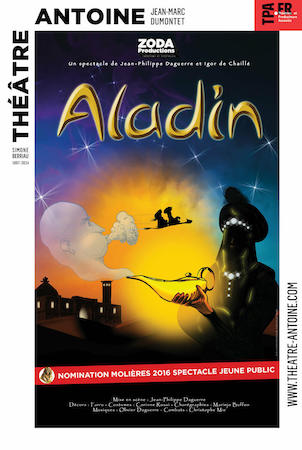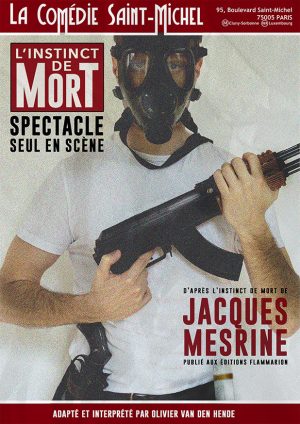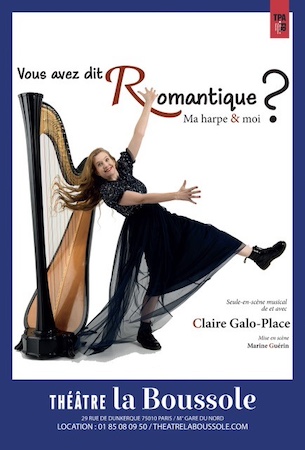Elephant de Gus Van Sant : le chaos en toute simplicité
Elephant, réalisé Gus Van Sant, est une véritable révolution du genre dramatique. Retour sur ce film qui transforme littéralement le temps, les personnages et la perception du mal.
Dans ce quartier résidentiel des États-Unis, une voiture zigzague : le père de John est une fois de plus ivre. John, une fois arrivé au lycée, se fait convoquer par le proviseur pour discuter de son énième retard. Pendant ce temps Elias prend des photos d’un jeune couple dans un parc. Michelle, élève complexée, termine sa leçon de sport avant de se rendre à la bibliothèque. Enfin, un groupe de filles anorexiques discutent durant le déjeuner, avant d’aller se faire vomir aux toilettes. Derrière ce calme apparent se prépare un drame. Deux étudiants, Alex et Eric, tous deux souffre-douleurs du lycée, mettent en pratique leur plan.
Voici l’histoire d’Elephant, réalisé par Gus Van Sant en 2003. Avant de raconter la tuerie de Colombine de 1999 dans le Colorado, Elephant est l’histoire d’une journée dans un lycée américain typique. Gus Van Sant propose une vision neutre, vide de toute interprétation, qu’elle soit sociologique ou psychologique. Pas d’émoi, pas d’explication. Juste les faits. Une mise en scène originale et osée qui a permis au réalisateur de recevoir la Palme d’or et le prix de la meilleure mise en scène.
Les mouvements de caméra, expression des émois intérieurs
Elephant est l’antithèse du film dramatique, alors même qu’il raconte un drame. Ce film est une peinture de la vie quotidienne. D’ailleurs, les acteurs sont amateurs et agissent de la même manière que si la caméra n’existait pas. Les prénoms, les styles vestimentaires sont identiques à la réalité. Pas de répliques ni de mise en scène préparées, pas d’artifice : nous suivons ces jeunes à la manière d’un documentaire. C’est un moyen de retranscrire en image une réalité intérieure : les dialogues sont minimalistes lorsqu’ils ne sont pas absents, l’image a pris le pas sur la parole pour retranscrire les sentiments.
Solitude et vacuité, voilà ce qui en ressort. L’identité visuelle de ce film, c’est bien sûr les interminables traveling, suivant de dos les personnages. Suppression de leur identité, de leur liberté, de leur parole, de leur visage, ces plans séquences donnent un sentiment d’enfermement, à la fois dans le campus et dans les pensées des personnages.
Michelle par exemple s’isole spatialement, rejetée par ses camarades. Elias subit un isolement sonore, la musique flottante accompagne son esprit de photographe. Le groupe des populaires et celui des solitaires s’enferment dans cette existence banale, futile, parfois presque morbide. Elephant raconte alors la superficialité de la vie quotidienne. Le débat sur l’homosexualité tourne en rond, tout autant que la caméra, formant un mouvement circulaire. Sans jamais se fixer sur un des personnages, si ce n’est par hasard, ce mouvement de caméra ne laisse aucune place à la parole, qui, de toute façon, ne dit rien.
Neutralité maximale : comment Elephant supprime le manichéisme ?
Cette suppression du pathos superflu permet de traiter les tueurs et les victimes à égalité. Plus de manichéisme donc, pour des destins mêlés et indéniablement liés. Les deux assassins ont des activités tout aussi banales que les autres personnages : ils jouent aux jeux vidéo, regardent la télévision, mangent des pancakes, et achètent une arme – rien d’anormal aux États-Unis-. Elephant renverse nos valeurs.
Cette normalité est d’autant plus affligeante par sa neutralité, qui elle-même ressort de la polyphonie du film. Le déroulement des faits se raconte grâce à plusieurs points de vue, les mêmes actions sont démultipliées et la temporalité devient malléable. Il n’y a aucune linéarité chronologique, les événements se croisent et se heurtent : l’avant et l’après, les causes et les effets sont bousculés : la neutralité est maximale. Pas d’explication, pas de parti pris, simplement des corps en mouvement.
Un traitement du temps particulier
Gus Van Sant construit une sorte de compte à rebours : le sujet du film est connu, la fin n’étonne pas. Le spectateur est dans l’attente constante, accentuée d’ailleurs par ces plans séquences qui ne racontent rien. La répétition des mêmes scènes retarde l’action et donne une impression de boucle sans fin. Les dernières minutes de calme, avant le drame, correspondent au moment où Elias prend John en photographie : les moindres détails d’une journée banale sont à prendre en compte et à apprécier. C’est d’ailleurs ce que le réalisateur met en avant avec les trois ralentis, qui représentent les seuls moments de bonheur éphémère qu’il est nécessaire de prolonger au maximum : Michelle admire le ciel changeant, le groupe de filles admire la beauté de Nathan et John joue avec son chien.
La première moitié du film ne raconte que quelques minutes de la journée, le temps est suspendu, et les deux tueurs en sont exclus. L’action s’accélère et devient linéaire dès lors que les deux tueurs montent dans la voiture pour mettre leur plan en action. Le destin est en marche et ne peut plus être interrompu.
Un film davantage poétique que dramatique
Par ce film, Gus Van Sant cherche à surpasser le traumatisme. Il le reprend, le répète, le remet en scène pour tenter de le maîtriser. Il montre l’inconcevable, l’incompréhensible, l’informulable. C’est bien cette vision artistique, conceptuelle et sensorielle, et non plus critique et réflexive, qui forme toute la poésie de ce film, touché par la grâce. La déambulation des personnages forme une danse macabre accompagnée de la Lettre à Elise ou Sonate au clair de lune, ils se croisent, se contournent comme ils contourneront plus tard la mort. Finalement, cette œuvre, bien qu’elle reprenne un fait récurrent de société inquiétant, n’a rien de sociologique. Gus Van Sant se place uniquement en tant qu’artiste et ne cherche pas à justifier l’action. Ces silences et ces hors-champs reflètent ce long cri d’incompréhension et de douleur qui se vit collectivement.
Angèle Correia
Articles liés

“Riding on a cloud” un récit émouvant à La Commune
A dix-sept ans, Yasser, le frère de Rabih Mroué, subit une blessure qui le contraint à réapprendre à parler. C’est lui qui nous fait face sur scène. Ce questionnement de la représentation et des limites entre fiction et documentaire...

“Des maquereaux pour la sirène” au théâtre La Croisée des Chemins
Victor l’a quittée. Ils vivaient une histoire d’amour fusionnelle depuis deux ans. Ce n’était pas toujours très beau, c’était parfois violent, mais elle était sûre d’une chose, il ne la quitterait jamais. Elle transformait chaque nouvelle marque qu’il infligeait...

La Croisée des Chemins dévoile le spectacle musical “Et les femmes poètes ?”
Raconter la vie d’une femme dans sa poésie propre, de l’enfance à l’âge adulte. En découvrir la trame, en dérouler le fil. Les mains féminines ont beaucoup tissé, brodé, cousu mais elles ont aussi écrit ! Alors, place à leurs...